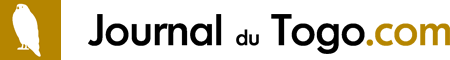L’universitaire et militante féministe ougandaise Stella Nyanzi, condamnée à 18 mois de prison en première instance pour avoir harcelé en ligne le président Yoweri Museveni, a été acquittée mercredi en appel.
Mme Nyanzi avait été inculpée et placée en détention en novembre 2018 pour avoir posté sur son compte Facebook des propos jugés « obscènes » à l’encontre du président Museveni et de sa mère, décédée en 2001.
Dans ses commentaires, elle avait fait référence à l’anniversaire du chef de l’État et regretté dans un langage cru que celui-ci ait vu le jour.
En août 2019, elle avait été condamnée à un an et demi de prison pour harcèlement en ligne, même si le tribunal n’avait pas retenu à son encontre l’accusation de « propos offensants ».
En 2017, Mme Nyanzi avait déjà été arrêtée et placée en détention pour avoir notamment comparé le président Museveni, au pouvoir depuis 1986, à une « paire de fesses ».
Le juge Peter Adonyo l’a acquittée mercredi en appel et a également rejeté un appel du parquet concernant l’accusation de « propos offensants ».
L’universitaire s’est adressée aux dizaines de ses partisans réunis devant le tribunal en leur demandant: « Pourquoi étais-je emprisonnée? Pourquoi suis-je restée en prison pendant autant de mois? ».
« Persécution », ont répondu ceux-ci. « Museveni doit partir! Museveni, vous avez été prévenu », a-t-elle ensuite crié, avant que la police n’essaie de disperser ses supporteurs.
Cette initiative a créé la confusion et Mme Nyanzi a semblé s’évanouir. Ses partisans l’ont alors emmenée à l’écart, pendant que les responsables de la prison où elle était détenue exigeaient qu’elles rentrent dans le tribunal pour être formellement relaxée.
Des agents pénitentiaires ont ensuite tenté de l’enlever aux mains de ses soutiens et tiré en l’air à plusieurs reprises, apparemment sans blesser personne, avant que l’universitaire soit finalement évacuée dans une voiture par ses proches.
Chercheuse associée à la prestigieuse université de Makerere à Kampala, Mme Nyanzi est titulaire d’un doctorat sur les sexualités en Afrique.
Interrogée par l’AFP courant 2017, elle justifiait le recours à un vocabulaire cru: « Les paroles dites vulgaires sont parfois la meilleure option pour faire passer un message ».
Ses commentaires sur Facebook, où elle est suivie par plus de 200.000 personnes, divisent la société ougandaise, un pays largement conservateur mais dont une partie de la population, notamment au sein de la jeunesse, souhaite le départ du président.
Le président Museveni dirige le pays d’une main de fer depuis 1986. Ses opposants l’accusent d’être de plus intolérant à toute forme de critiques et la population a peu confiance dans l’indépendance de la justice.