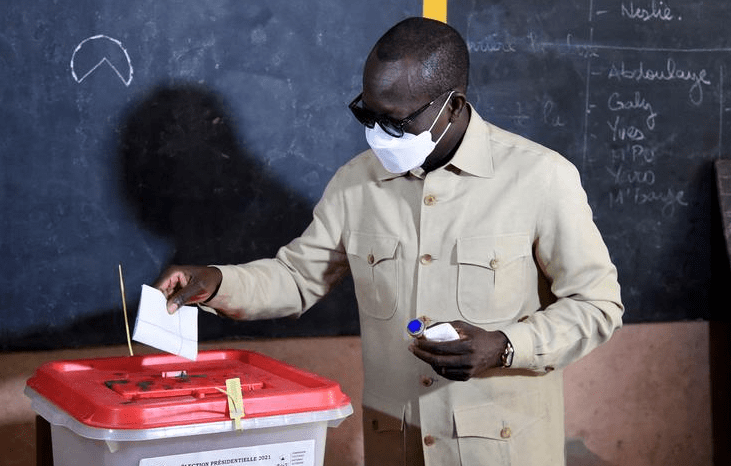Au moins six élections présidentielles sont prévues en 2023 sur le continent africain et trois d’entre elles concerneront des pays de sa partie ouest.L’importance de ces scrutins en 2023 est telle que le président américain Joe Biden a réuni mi-décembre, en marge du sommet Afrique – Etats-Unis, les dirigeants des six pays africains concernés. Lors de cette réunion avec le Gabonais Ali Bongo, le Nigerian Muhammadu Buhari, le Liberian George Weah, le Sierra Leonais Julius Maada Bio, le Malgache Andry Rajoelina et le Congolais Félix Antoine Tshisekedi, M. Biden les a appelés à faire de tout leur possible pour que les élections qui se dérouleront dans leurs pays cette année soient « libres, justes et crédibles ».
Au Nigeria d’abord, le président Buhari va passer le flambeau après le scrutin présidentiel du 25 février. Élu pour la première fois en 2015, le dirigeant octogénaire va boucler son second mandat consécutif dans deux mois et ne peut plus se présenter selon la Constitution nigériane. Il laissera cependant ce géant du continent, fort de plus de 200 millions d’habitants, dans une crise économique que son successeur devra s’atteler à résoudre en plus des questions sécuritaires dont le terrorisme islamiste.
Alors que Buhari a été la cible fin décembre d’une tentative d’assassinat revendiquée par le groupe terroriste Etat islamique (EI) lors d’une visite au sud-ouest d’Abuja, le parti au pouvoir a désigné Bola Ahmed Tinubu comme probable futur successeur du chef de l’Etat nigérian. Le candidat du parti au pouvoir sera aux prises avec trois principaux adversaires : Atiku Abubakar, leader du Parti démocratique populaire (PDP), la principale formation de l’opposition, Peter Obi, leader du Parti travailliste et Rabiu Kwankwaso du New Nigerian Peoples Party. Selon plusieurs observateurs, le successeur de Muhammadu Buhari ne devrait pas sortir de cette liste.
À la croisée des chemins
La deuxième élection présidentielle ouest-africaine de cette année, prévue le 24 juin, concerne la Sierra Leone, ce petit pays anglophone de huit millions d’habitants dirigé depuis avril 2018 par Julius Maada Bio. Alors qu’il brigue un second mandat, il a suscité cinq mois en arrière la colère d’une partie de la population qui était sortie manifester contre la vie chère. Les émeutes qui s’en sont suivies ont provoqué la mort de plusieurs civils et policiers, obligeant le président Bio à décréter un couvre-feu au niveau national.
Voulant coûte que coûte le départ de Julius Maada Bio, les leaders de quinze partis de l’opposition ont entamé des discussions pour investir un candidat unique. Quelques semaines avant l’annonce officielle de la date des élections générales par la Commission électorale, ils accusaient le parti au pouvoir de vouloir les déplacer en 2024. Cependant, les rivalités entre les responsables politiques de l’opposition autour du projet de coalition unique pourraient constituer un avantage pour le président sortant en vue des prochaines échéances.
Au Liberia voisin, la présidentielle doit s’y tenir en octobre 2023 sur fond de tensions entre le duo gagnant de 2016. Les dirigeants de la coalition au pouvoir veulent reconduire le président sortant George Weah et sa vice-présidente, Jewel Howard Taylor, l’ex-épouse de Charles Taylor, ancien président du pays. Cependant, certains journaux affirment que les deux collaborateurs ne s’entendent plus tandis que le président Weah doit faire face à une opposition désormais réunie autour d’une coalition dirigée par Alexander Cummings, leader de l’Alternative National Congress (ANC), qui veut battre l’ancien footballeur au premier tour.
Bilan mitigé, bilan éprouvé
Les adversaires de George Weah lui reprochent surtout son bilan mitigé dans la lutte contre la pauvreté et ses fréquents déplacements à l’étranger, abandonnant la population à son sort. Lors de la dernière Coupe du monde de football, le seul Africain qui a remporté le Ballon d’or européen (France Football) est resté plusieurs jours au Qatar pour regarder particulièrement l’un de ses enfants, Timothy Weah, pensionnaire de l’équipe nationale des Etats-Unis.
A Madagascar, le président Andry Rajoelina n’a toujours pas déclaré sa candidature pour l’élection présidentielle de novembre. En revanche, il continue des tournées à l’intérieur du pays qualifiées de pré-campagne électorale par certains observateurs. Face à une délicate épreuve du bilan, il doit trouver les bons mots pour convaincre les citoyens malgaches. Avant son élection en 2018, Andry Rajoelina avait notamment promis de rattraper en cinq ans le retard économique dans lequel est plongé son pays depuis son indépendance, en 1960.
La tâche ne sera pas facile pour lui face à une opposition qui a décidé d’unir ses forces. En novembre 2021, dix-sept de ses formations ont réussi à mettre sur pied la plateforme Panorama. Elle compte parmi ses principaux leaders l’ancien président Hery Rajaonarimampianina et son prédécesseur Marc Ravalomanana, qui occupe le statut d’invité pour l’instant. Le lancement de ce groupe d’opposition a été surtout marqué par la poignée de main, en guise de réconciliation, entre le député Roland Ratsiraka et Marc Ravalomanana. Un mauvais signe pour le président sortant ?
A l’inverse, en République démocratique du Congo (RDC), l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS, au pouvoir) a organisé un premier congrès le 15 décembre dernier pour désigner Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat à la présidentielle du 20 décembre 2023. A la tête de ce pays de 90 millions d’habitants depuis janvier 2019, le président sortant n’a pas caché sa volonté de briguer un nouveau mandat.
De l’argument des armes au pouvoir du dialogue
Toutefois, des problèmes subsistent sur l’enrôlement des électeurs, une opération perturbée par les violences qui se poursuivent à l’est du pays entre les forces armées républicaines et les rebelles du M23 soutenus, selon Kinshasa, par le Rwanda voisin. Cette situation est d’autant plus inquiétante parce que des Congolais de certaines villes du Nord-Kivu, une province qui concentre un nombre important d’électeurs, n’avaient pas pu voter lors des élections précédentes.
Dans cette situation de crise sécuritaire et face à l’éventualité d’un report du scrutin en 2024, l’opposant Martin Fayulu, qui revendique toujours la victoire lors de la présidentielle de 2018, a déjà invité le président Tshisekedi à quitter le pouvoir dans les délais constitutionnels. Cependant, à onze mois du scrutin présidentiel, les déclarations de candidature se multiplient. Après Martin Fayulu, considéré comme un sérieux prétendant au fauteuil présidentiel, l’ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, a également dit son intention de succéder à Félix Tshisekedi qui n’a par contre pas dit son dernier mot.
Au Gabon, où la Constitution ne limite pas les mandats présidentiels, le président Ali Bongo, à la tête du pays depuis 2009, devrait sans doute briguer un troisième septennat lors des élections générales (présidentielle, législatives, locales et sénatoriales) prévues au second semestre de 2023. Alors qu’il souffre encore des séquelles de l’AVC qui l’a terrassé en 2018, Ali Bongo a récolté ces dernières semaines des motions de soutien à sa probable candidature à la présidentielle lors des conseils provinciaux du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir).
Pour l’heure, les responsables du pouvoir et de l’opposition ne sont pas d’accord sur des questions liées à la révision des listes électorales. Ces querelles rappellent les violentes contestations qui avaient écorné la victoire d’Ali Bongo en 2016 après que Jean Ping, principal opposant à l’époque, a rejeté les résultats du scrutin présidentiel.
Pour ne pas réveiller le spectre, le chef de l’Etat gabonais s’est adressé particulièrement, à l’occasion de son discours du nouvel an, à l’opposition. Dans son message, il dit accepter de s’asseoir avec ses adversaires dans les meilleurs délais en vue de discuter de la transparence électorale lors des élections générales de 2023.
Zimbabwe, Sud Soudan, Libye ou l’incertitude
Au Zimbabwe, la date des élections générales attendues en 2023 n’est pas encore précisée par la Commission électorale. Elle indique juste qu’elles vont se tenir entre juillet et août 2023. Arrivé au pouvoir en 2018 avec 50,8 % des suffrages, le président Emmerson Mnangagwa aura comme principal adversaire, s’il décide de se représenter, Nelson Chamisa, le leader de la Coalition des citoyens pour le changement (CCC) qui avait obtenu 44,3 % lors de la dernière présidentielle.
Pour leur part, les dirigeants Sud-Soudanais ont reporté les élections générales qui devaient se tenir dans le pays en février 2023 sans fixer officiellement une nouvelle date. Mais d’après l’AFP, le Mouvement populaire de libération du Soudan a approuvé en décembre la candidature du président Salva Kiir pour un nouveau mandat lors des élections prévues pour la fin de l’année 2024. Celles-ci devaient mettre fin à la transition qui, dès 2020, a succédé à la guerre civile (2013-2020) dans ce pays qui a pris son indépendance du Soudan en 2011.
Ailleurs en Afrique, en Libye plus exactement, l’incertitude plane encore sur la tenue en 2023 des élections initialement prévues en décembre en raison de l’impasse politico-militaire. Le Premier ministre sortant, Abdelhamid Dbeibah, s’est montré toutefois optimiste quant à leur organisation cette année. Il multiplie les initiatives pour tenter de rapprocher les parties opposées dans ce pays devenu presque un Etat failli depuis la révolution qui a renversé Mouammar Kadhafi, en 2011.
La communauté internationale suit de près cette crise à laquelle elle tente de remédier inlassablement. En septembre dernier, l’ancien ministre sénégalais Abdoulaye Bathily a été nommé nouveau représentant des Nations Unies à Tripoli. Si certains acteurs croient que les élections doivent passer par une réconciliation préalable, M. Bathily conduit pour sa part une feuille de route qui prévoit en priorité « d’organiser un dialogue entre les gouvernements libyens rivaux avec, comme objectif ultime, d’organiser des élections consensuelles », affirmait une source onusienne interrogée par RFI.