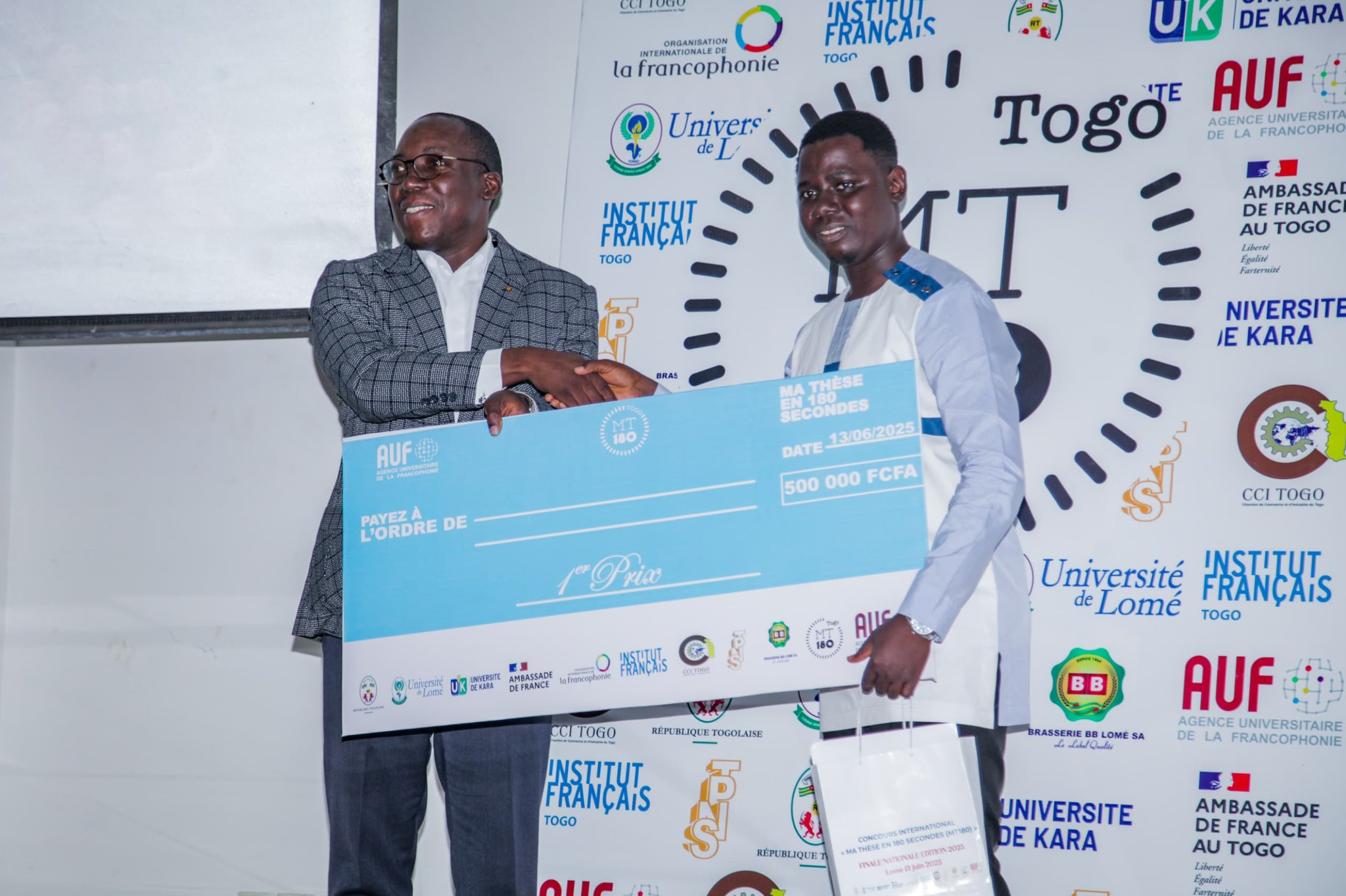Aného : Un péage ultramoderne sur la RN2, symbole d’un Togo en route vers l’avenir
Lomé, 18 juin 2025 — La ville d’Aného, joyau historique niché à 40 kilomètres de Lomé, s’apprête à inaugurer un poste de péage d’avant-garde sur la Route Nationale 2 (RN2), demain 19 juin 2025. En effet , Cet événement marquera une nouvelle étape dans la modernisation des infrastructures togolaises. Annoncée par le ministère des Transports le 17 juin, cette mise en service, fruit d’un chantier achevé avec une précision d’orfèvre, transfère les opérations de collecte des droits d’usage depuis l’ancien site provisoire de Vodougbé vers cette structure flambant neuve. Dans un pays où la fluidité des axes routiers est un levier de prospérité, ce péage incarne l’ambition d’un Togo résolu à conjuguer modernité et résilience, malgré une contraction budgétaire pour l’entretien routier en 2025.
RN2 : une infrastructure clé pour la connectivité togolaise
Érigé à l’entrée d’Aného, ce poste de péage, d’une architecture épurée et fonctionnelle, intègre des technologies de pointe : couloirs automatisés, paiements par mobile money et vignettes rechargeables. Toutes ces innovations sont pilotées par la Société Autonome de Financement de l’Entretien Routier (SAFER). Cette infrastructure, financée à hauteur de 1,2 milliard de FCFA dans le cadre de la réhabilitation de la RN2, s’inscrit dans un vaste chantier lancé en 2020. Ce projet comprend l’élargissement de la section Avépozo-Togokomé en 2×2 voies et la réfection du tronçon Togokomé-Aného. Avec un trafic quotidien de 8 000 véhicules, selon les données du ministère des Travaux Publics, la RN2, reliant Lomé à la frontière béninoise, est un corridor vital du réseau Abidjan-Lagos, un axe stratégique de la CEDEAO.
Péage d’Aného : plus de revenus, moins de fraude pour l’entretien routier
La SAFER voit dans ce péage un outil décisif pour mobiliser des ressources. En 2024, les 13 postes de péage automatisés du pays, dont ceux de Davié et Aképédo, ont généré 18 milliards de FCFA, couvrant 45 % des besoins d’entretien routier estimés à 41 milliards. Le nouveau poste d’Aného, équipé de caméras de surveillance et d’un système de comptage d’essieux, promet aussi d’accroître cette manne, tout en fluidifiant le trafic et en réduisant les fraudes. « Ce péage n’est pas qu’un point de collecte ; c’est une sentinelle de notre ambition logistique », a déclaré un responsable de la SAFER, soulignant son rôle crucial dans la compétitivité du corridor togolais.
Défi budgétaire : le Togo maintient le cap sur ses ambitions
Cette inauguration intervient dans un contexte paradoxal : le budget alloué à l’entretien routier pour 2025, amputé de 20 % pour s’établir à 13,3 milliards de FCFA contre 16,5 milliards en 2024, suscite des inquiétudes. Avec 4 600 des 11 777 km de routes togolaises en état de dégradation, selon l’Agence Ecofin, ce resserrement budgétaire met la SAFER sous pression pour optimiser ses ressources.
Togo, hub logistique : la modernisation au service du développement
Pourtant, le Togo ne dévie pas de sa feuille de route. Aligné sur le Plan National de Développement (PND 2018-2022) et la Feuille de Route 2020-2025, le gouvernement mise sur des infrastructures modernes pour consolider son statut de hub logistique ouest-africain. Le port de Lomé, qui a manutentionné 1,9 million d’EVP en 2023, et la Plateforme Industrielle d’Adétikopé, opérationnelle depuis 2022, dépendent de corridors routiers fiables comme la RN2. L’inauguration du péage d’Aného, financée en partie par la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), illustre cette synergie entre innovation et intégration régionale, malgré les contraintes financières.
Aného : un symbole d’avenir et de progrès pour le Togo
À Aného, ville au riche passé colonial et carrefour commercial, ce péage est plus qu’une infrastructure : il est aussi un catalyseur d’espoir. Les habitants, qui ont souffert des embouteillages et des routes dégradées, saluent une initiative qui promet d’améliorer la sécurité et l’accessibilité. « Ce poste moderne redonne du lustre à notre ville et facilite les échanges avec le Bénin », confie Kossi, commerçant local. En parallèle, le Ministère des Transports annonce des enquêtes de satisfaction des usagers en 2025, une démarche novatrice pour ajuster les politiques routières aux attentes des citoyens.
Aného en pleine mutation : le Togo fonce vers la modernité
En somme, avec l’inauguration de ce péage d’avant-garde, Aného ne se contente pas d’améliorer la fluidité routière ; elle incarne la détermination du Togo à bâtir un avenir moderne et connecté. Cette infrastructure est un pas de plus vers la consolidation du pays en tant que véritable hub logistique pour l’Afrique de l’Ouest. Le Togo continue de tracer sa voie, alliant ambition et innovation pour une prospérité durable. Un signal fort envoyé à la région et au-delà !







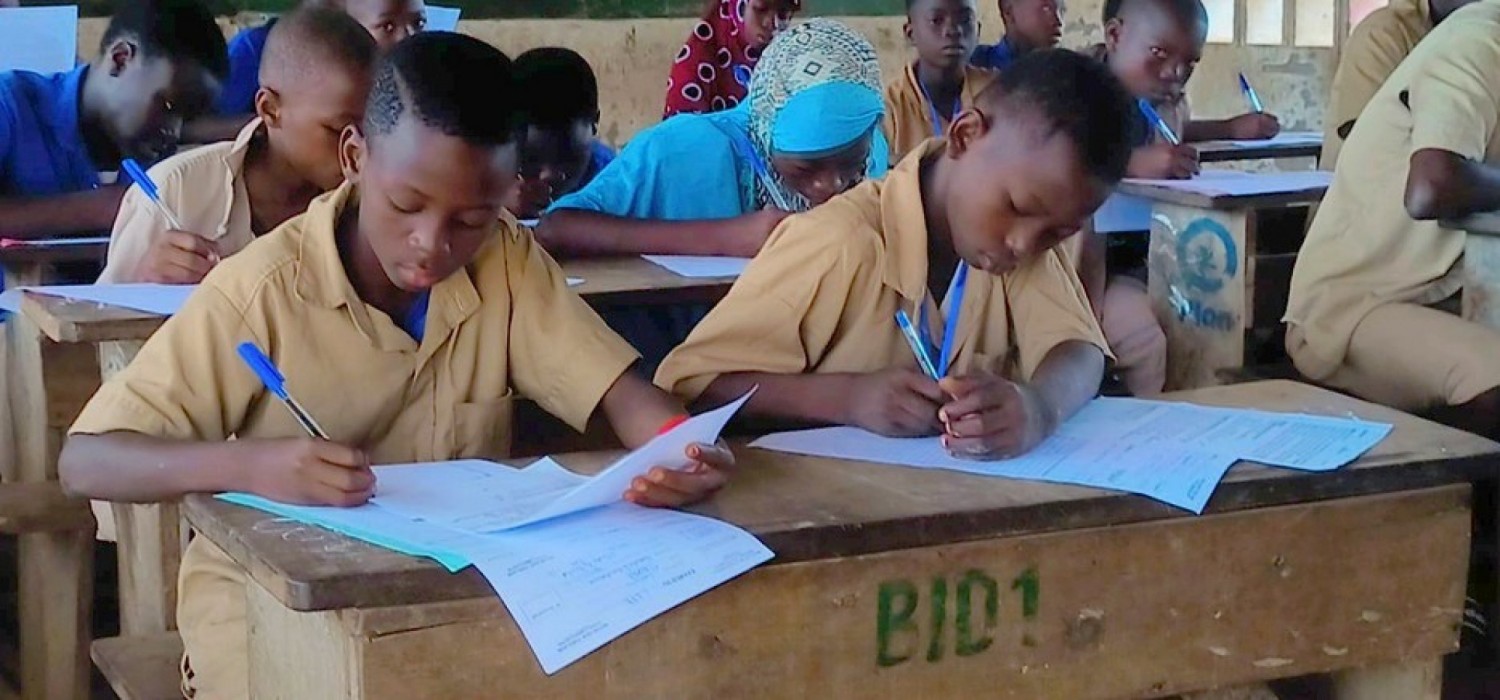
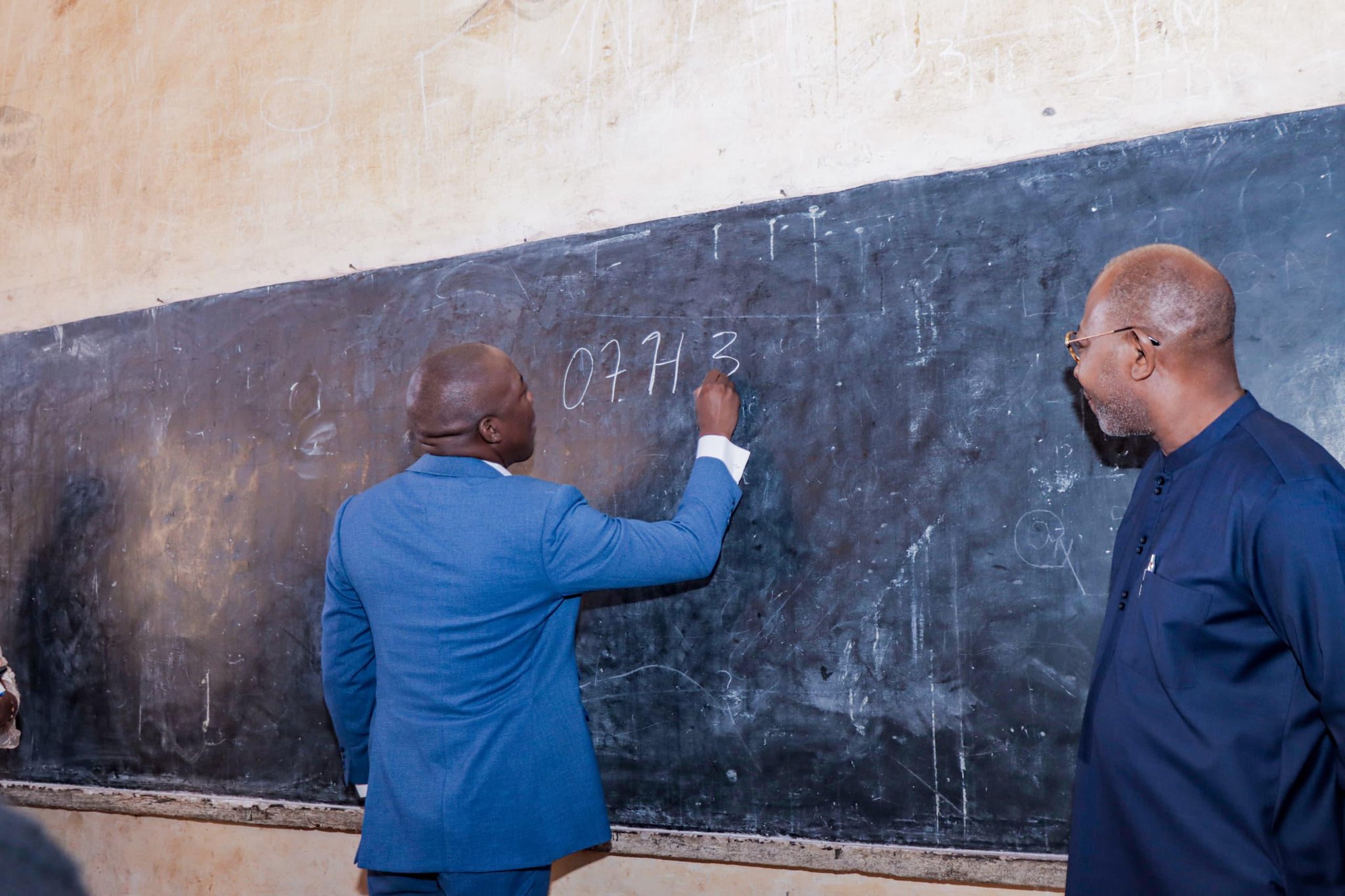

 Des voix qui portent : l’appel vibrant des parlementaires et de l’UNICEF
Des voix qui portent : l’appel vibrant des parlementaires et de l’UNICEF Le Ministre de l’Action sociale face aux défis : une volonté inébranlable
Le Ministre de l’Action sociale face aux défis : une volonté inébranlable Quand les enfants interpellent les élus : un dialogue inédit
Quand les enfants interpellent les élus : un dialogue inédit Un manifeste pour demain : les enfants dessinent l’avenir du
Un manifeste pour demain : les enfants dessinent l’avenir du