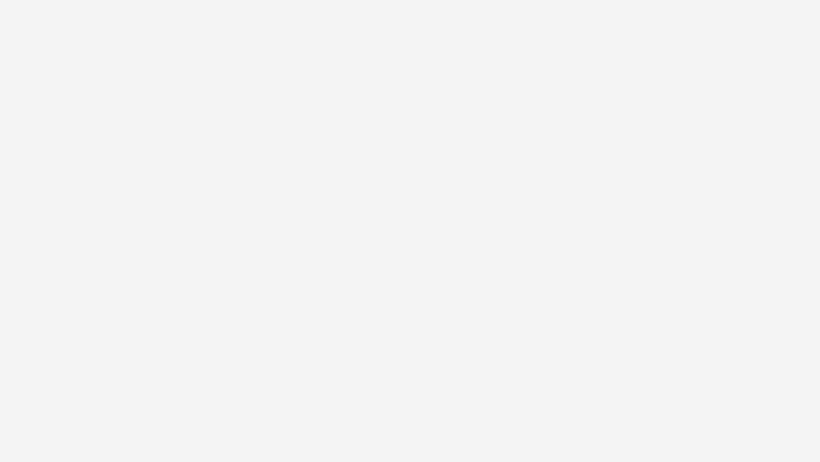Journaliste et analyste politique nigérien, Moussa Aksar analyse les enjeux de la l’élection présidentielle prévue le 27 décembre prochain au Niger et à l’issue de laquelle, le président Mahamadou Issoufou espère céder sa place à son ami et dauphin désigné́, Mohamed Bazoum.Quels sont les principaux enjeux de cette élection ?
L’enjeu majeur de cette élection est pour les Nigériens de dresser le bilan des dix ans de gouvernance du président Mahamadou Issoufou qui achève son second et dernier mandat légal et dont l’ami et compagnon au pouvoir, Mohamed Bazoum, est le dauphin désigné.
Les électeurs nigériens vont-ils sanctionner le régime sortant en éliminant son candidat, ou bien lui donneront-ils une nouvelle chance en fermant les yeux sur les excès et fautes qu’une grande partie de l’opinion lui reproche? Les paris sont ouverts à ce stade.
Quels sont les griefs de l’opposition contre le régime sortant?
Beaucoup d’adversaires du régime estiment que depuis l’arrivée au pouvoir du président Mahamadou Issoufou en 2011, le pays a connu quelques reculs nets sur le plan de la construction démocratique. Des partis politiques ont été́ divisés, parfois avec des moyens pas très honorables: recours au chantage, usage des prébendes à l’égard de certains hommes et partis politiques, l’achat de consciences, etc.
En plus, pour la première fois depuis la Conférence nationale souveraine de 1991 qui a mis fin au régime du parti unique et instauré le multipartisme, le Niger s’apprête à vivre des élections sans la présence d’un organisme consensuel chargé d’organiser le scrutin. L’actuelle CENI (Commission électorale nationale indépendante) qui est en charge de cette présidentielle, mais aussi des législatives qui sont organisées en même temps, n’a pas fait l’objet d’une composition consensuelle entre les différents acteurs politiques.
Durant les dix ans de règne du président Issoufou, certains Nigériens ont aussi eu l’impression que la justice, socle de tout Etat démocratique, n’a pas fonctionné de la même manière pour tout le monde. Elle a été́ à géométrie variable. C’est dire qu’une victoire, au moyen de ce fameux « Un coup KO » au premier tour, du candidat du pouvoir ne sera pas aussi facile comme le prétendent ses partisans. Sauf à utiliser des moyens pas recommandables en démocratie.
Certains adversaires de Mohamed Bazoum contestent sa nationalité́ nigérienne. Est-ce qu’une partie des hommes politiques du Niger est aussi touchée par les virus nationalistes comme cela avait été́ le cas en Côte d’ivoire avec le concept de « l’ivoirité » qui a provoqué une sanglante crise aux allures de conflit ethnique dans ce pays?
L’histoire du Niger, sa composition ethnique et les liens entre les communautés l’éloignent nettement de la Côte d’Ivoire où certains hommes politiques ont voulu dans les années 1990 empêcher l’actuel président Alassane Ouattara de postuler à la présidence pour avoir été́ un moment porteur présumé́ de la nationalité́ du Burkina voisin. Ce n’est pas ce qui est reproché à Bazoum par ses adversaires au Niger. Au fond, personne ne dit qu’il n’est pas Nigérien. Ses adversaires qui se basent sur la loi qui dit qu’un candidat à la présidentielle doit être nigérien d’origine, lui reprochent d’avoir fourni deux documents d’état civil différents à la Cour Constitutionnelle qui valide les candidatures. Or, celle-ci a validé la sienne mais elle n’a pas pu taire la polémique. Certains de ses adversaires espèrent d’ailleurs encore invalider cette candidature, même si leurs chances semblent s’affaiblir avec les rejets réguliers des recours successifs introduits jusqu’ici.