Une alliance sacrée pour la paix : le Togo réunit ses gardiens ancestraux à Dapaong et lance une tournée nationale cruciale
C’est sous le ciel ardent de Dapaong, ville carrefour du nord togolais, à quelque 600 kilomètres de la bouillonnante Lomé, que s’est ouvert, ce 16 juin 2025, un chapitre décisif pour l’avenir du pays. AWATE Hodabalo, Ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie traditionnelle, a donné le coup d’envoi d’une tournée nationale d’envergure. En effet, il s’agit d’une odyssée consultative visant à rallier les chefs traditionnels, ces vigies immémoriales des valeurs togolaises, dans une quête commune de cohésion et de stabilité. Sous le regard bienveillant du Président du Conseil, SEM Faure Essozimna Gnassingbé, cette initiative se veut un rempart contre les fractures sociales, à l’heure où les élections municipales de 2025 pointent à l’horizon. Le Togo joue gros : l’unité du pays en dépend !
Chefferie traditionnelle : un rôle clé dans la gouvernance moderne
Dans l’enceinte vibrante de cette rencontre, les silhouettes majestueuses des chefs traditionnels se sont mêlées aux costumes impeccables des gouverneurs, préfets et maires, formant une mosaïque d’autorités unies par un même dessein. Le Ministre, avec une éloquence teintée de ferveur, a exalté la mission de ces dépositaires des coutumes : « Ils sont les artisans d’une paix durable, les passeurs d’un héritage qui doit éclairer notre gouvernance moderne. » En effet, cette tournée, loin d’être une simple formalité, ambitionne de redessiner les contours d’une collaboration féconde entre l’État et ces figures vénérées, désormais pleinement reconnues dans l’intitulé même du ministère.
 Défis et solutions : le dialogue pour conjurer les tempêtes foncières
Défis et solutions : le dialogue pour conjurer les tempêtes foncières
Les échanges, d’une densité rare, ont mis en lumière des enjeux cruciaux. Ainsi, Affoh Atcha-Dedji, gouverneur des Savanes, a porté à la tribune les tourments qui ébranlent les fondations de la chefferie : des villages « flottants », ces terres indécises suspendues entre deux juridictions, et une poussée désordonnée de hameaux nouveaux, semant discorde et rivalités foncières. « Ces plaies, si elles ne sont pas pansées, menacent l’harmonie dont nous avons tant besoin en cette veille électorale », a-t-il averti, le ton grave. Face à ces écueils, le ministre AWATE a prôné une approche résolue, invitant les chefs à devenir les architectes d’une gestion territoriale apaisée, en synergie avec les pouvoirs publics.
Trois axes majeurs ont guidé les débats, tels des phares dans la nuit : le rôle des conseils traditionnels dans une administration efficace et un scrutin serein, les liens à tisser entre ces instances et les édiles locaux, et l’inscription de la chefferie dans le renouveau de la Cinquième République. Chaque thème, abordé avec une rigueur presque sacrée, a révélé une ambition : faire des traditions un levier de modernité, un socle pour une démocratie vivante et inclusive.
Dapaong, symbole de l’unité : les sentinelles d’un Togo nouveau
Cette tournée, qui sillonnera les régions jusqu’au 20 juin, n’est pas qu’un éphémère conciliabule. Elle incarne une vision audacieuse : celle d’un Togo où les racines ancestrales irriguent les aspirations d’aujourd’hui. En conviant les chefs à formuler leurs doléances et à enrichir les orientations ministérielles, AWATE Hodabalo leur offre une tribune, mais aussi une responsabilité. « Nous bâtissons ensemble une gouvernance où la voix des anciens résonne dans les choix du présent », a-t-il proclamé, scellant ainsi un pacte implicite entre passé et avenir.
En somme , au-delà des défis, c’est un souffle d’espoir qui traverse Dapaong et au-delà. Ces concertations dessinent les contours d’un vivre-ensemble raffermi, où les tensions s’effacent devant la sagesse collective. En plaçant les chefs traditionnels au cœur de ce dialogue, le Togo ne se contente pas de célébrer son héritage ; il le réinvente, le parant d’une nouvelle mission : être les gardiens d’une nation en paix, prête à affronter les urnes et les défis du siècle avec une dignité intacte. Le Togo se tourne vers ses racines pour mieux construire son avenir : une stratégie gagnante ?



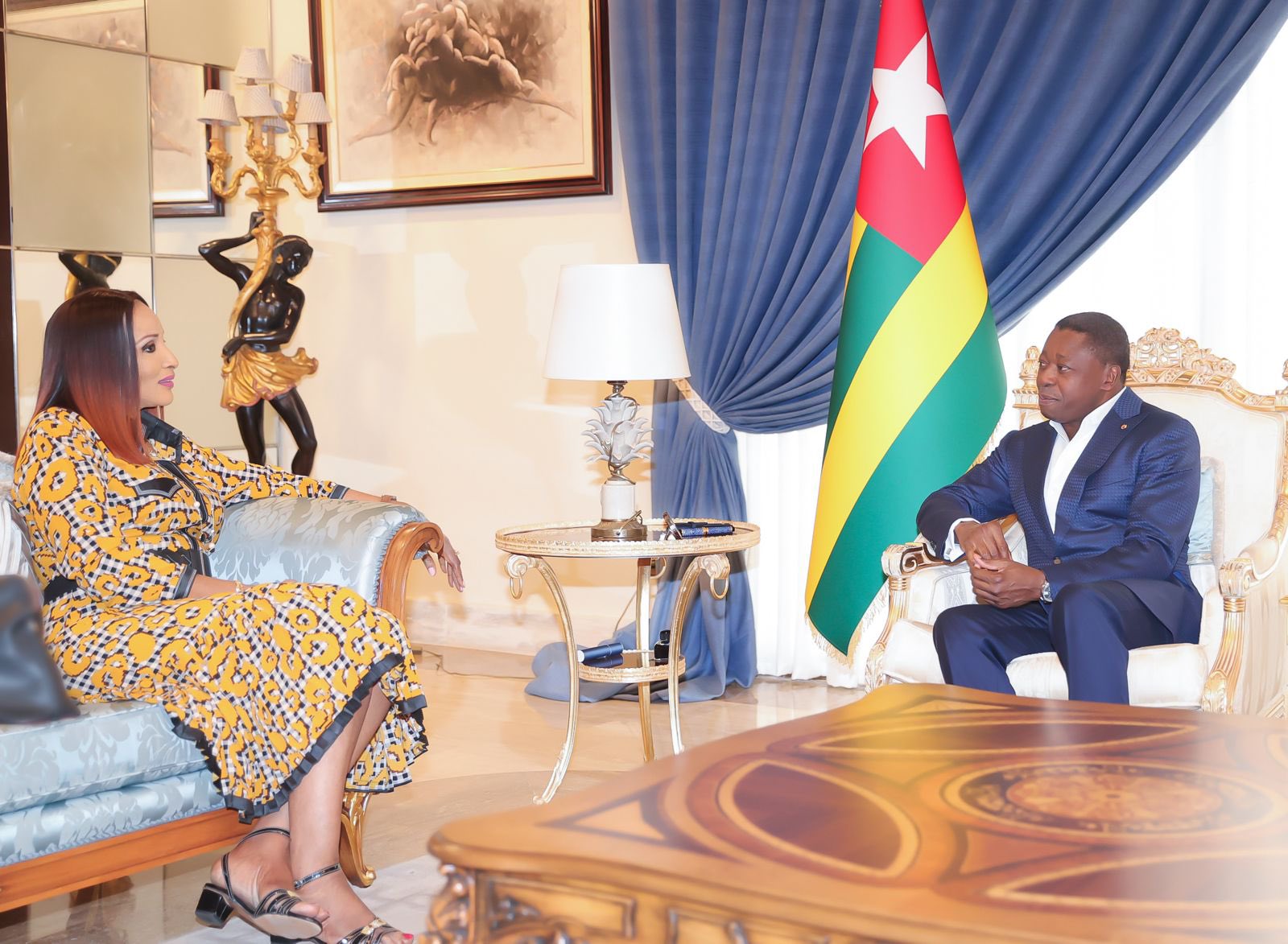

 Vers une CEDEAO des peuples : L’Afrique de l’Ouest à la croisée des chemins
Vers une CEDEAO des peuples : L’Afrique de l’Ouest à la croisée des chemins
 Traumatismes de guerre : quand la santé évacue le bilan humain
Traumatismes de guerre : quand la santé évacue le bilan humain


 Pont vers la modernité : L’Allemagne offre des outils numériques à la formation togolaise
Pont vers la modernité : L’Allemagne offre des outils numériques à la formation togolaise Togo-Allemagne : l’éducation, fer de lance d’un avenir prometteur pour la jeunesse
Togo-Allemagne : l’éducation, fer de lance d’un avenir prometteur pour la jeunesse
 Renouveau stratégique : le Groupe des Ambassadeurs opère un virage décisif
Renouveau stratégique : le Groupe des Ambassadeurs opère un virage décisif Sous l’égide ivoirien : réorganisation et poids diplomatique accrus
Sous l’égide ivoirien : réorganisation et poids diplomatique accrus Le rôle clé du Togo : Lomé, acteur incontournable de l’Unité Ouest-Africaine
Le rôle clé du Togo : Lomé, acteur incontournable de l’Unité Ouest-Africaine
 Des semences d’espoir : 2500 producteurs bientôt transformés
Des semences d’espoir : 2500 producteurs bientôt transformés 