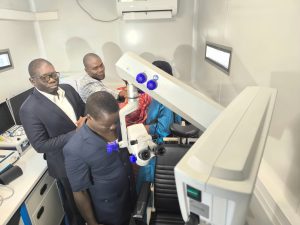Thaïlande : La Première ministre Paetongtarn Shinawatra destituée par la Cour constitutionnelle, un nouveau coup dur pour le clan Shinawatra
Dans un verdict retentissant, la Cour constitutionnelle thaïlandaise a prononcé, ce vendredi 29 août 2025, la destitution de la Première ministre Paetongtarn Shinawatra, accusée d’avoir enfreint les normes éthiques dans l’exercice de ses fonctions. Cette décision, prise à une majorité de sept voix contre deux, plonge la Thaïlande dans une nouvelle spirale d’incertitude politique, marquant un tournant dramatique pour la dynastie Shinawatra, qui domine la scène politique du royaume depuis plus de deux décennies.
Une conversation controversée scelle son destin politique
La chute de Paetongtarn Shinawatra, âgée de 39 ans, découle d’une conversation téléphonique controversée avec l’ancien dirigeant cambodgien Hun Sen, enregistrée et diffusée sans son consentement en juin 2025. Lors de cet échange, destiné à apaiser les tensions frontalières entre Bangkok et Phnom Penh, la Première ministre a adopté un ton jugé trop conciliant et a qualifié un général thaïlandais d’« adversaire », provoquant l’ire des cercles nationalistes et militaires. Par conséquent, les sénateurs conservateurs, à l’origine de la plainte déposée auprès de la Cour, ont dénoncé une violation des standards éthiques inscrits dans la Constitution thaïlandaise.
Ce verdict, rendu après des semaines de délibérations, fait de Paetongtarn la troisième représentante du clan Shinawatra à perdre le pouvoir, après son père Thaksin (2001-2006) et sa tante Yingluck (2011-2014), tous deux renversés par des coups d’État militaires. La Cour constitutionnelle, souvent accusée de partialité en faveur de l’establishment militaro-royaliste, avait déjà destitué l’an dernier le prédécesseur de Paetongtarn, Srettha Thavisin, pour des motifs similaires, renforçant les critiques sur son rôle dans la fragilisation des gouvernements élus.
Thaïlande : une crise politique qui s’aggrave
La destitution de Paetongtarn Shinawatra intervient dans un contexte de tensions croissantes, tant sur le plan intérieur qu’international. Les affrontements armés à la frontière avec le Cambodge, déclenchés par la mort d’un soldat cambodgien en mai 2025, ont exacerbé les rivalités historiques entre les deux nations. La fuite de l’appel téléphonique, attribuée à Hun Sen, a non seulement discrédité Paetongtarn aux yeux de l’opinion publique, mais a également provoqué la rupture de la coalition gouvernementale. Le parti Bhumjaithai, pilier de l’alliance avec le Pheu Thai, le parti familial des Shinawatra, s’est retiré en juin, laissant le gouvernement avec une majorité fragile au Parlement.
Cette instabilité politique menace de paralyser le royaume, alors qu’aucun successeur clair n’émerge. Selon la Constitution thaïlandaise, seuls les candidats déclarés comme prétendants au poste de Premier ministre lors des élections de 2023 sont éligibles. Parmi eux, plusieurs sont déjà inéligibles, et les autres, comme Anutin Charnvirakul du parti Bhumjaithai ou Chaikasem Nitisiri du Pheu Thai, font face à des obstacles politiques ou de santé. L’absence de leadership stable pourrait retarder les décisions cruciales, notamment sur le plan économique, alors que la Thaïlande négocie avec les États-Unis pour alléger des droits de douane menaçant ses exportations.
Le déclin de la dynastie Shinawatra ?
L’éviction de Paetongtarn marque un nouveau revers pour la dynastie Shinawatra, qui incarne depuis les années 2000 une alternative populiste à l’élite conservatrice alignée sur la monarchie et l’armée. Bien que Thaksin Shinawatra, figure centrale du clan, ait récemment échappé à une condamnation pour lèse-majesté dans un procès distinct, clos le 22 août 2025, une autre procédure pour violation des conditions de sa détention reste en cours, ajoutant à l’incertitude pesant sur la famille.
Les analystes, comme Thitinan Pongsudhirak, professeur à l’université Chulalongkorn, estiment que cette crise pourrait signaler la fin de l’influence des Shinawatra sur la politique thaïlandaise. « La dynastie Shinawatra est confrontée à une érosion critique de son pouvoir », a-t-il déclaré, soulignant l’impact des pressions judiciaires et des divisions internes au sein de la coalition Pheu Thai.
Une histoire d’instabilité chronique
La Thaïlande, deuxième économie d’Asie du Sud-Est, est habituée aux soubresauts politiques. Depuis la fin de la monarchie absolue en 1932, le pays a connu une douzaine de coups d’État, dont le dernier en 2014. Les tensions entre les forces progressistes, représentées par le Pheu Thai et le défunt parti Move Forward, dissous en août 2024, et l’establishment conservateur continuent de fragmenter le paysage politique. La décision de la Cour constitutionnelle ravive les craintes de manifestations massives, comme celles observées le 2 août 2025 à Bangkok, où des milliers de personnes ont exigé la démission de Paetongtarn.
L’économie thaïlandaise sous pression
Outre l’instabilité politique, la Thaïlande fait face à des défis économiques. La croissance, déjà ralentie depuis la pandémie (2,5 % en 2022, 1,9 % en 2023), reste en deçà des performances des autres économies régionales. Le programme de relance économique de Paetongtarn, incluant la distribution de 10 000 bahts via un « portefeuille numérique », visait à stimuler la consommation, mais son avenir est désormais incertain. De surcroît, les négociations commerciales avec les États-Unis, cruciales pour éviter des droits de douane de 36 %, risquent de pâtir de cette vacance du pouvoir.
Un avenir incertain pour la Thaïlande
Alors que la Thaïlande s’enfonce dans une nouvelle période de turbulences, le verdict de la Cour constitutionnelle pourrait ouvrir la voie à des élections anticipées, bien que cette option reste incertaine. En attendant, le vice-Premier ministre Suriya Juangroongruangkit assure l’intérim, mais son mandat s’achève avec l’entrée en vigueur d’un remaniement ministériel prévu pour le 30 août 2025. Paetongtarn Shinawatra, qui avait promis d’améliorer la qualité de vie des Thaïlandais lors de son élection en août 2024, a vu son mandat écourté par une décision judiciaire qui reflète les luttes de pouvoir historiques au sein du royaume.
Alors que les regards se tournent vers le Parlement pour désigner un nouveau chef du gouvernement, la Thaïlande reste suspendue à un avenir politique incertain, marqué par les rivalités entre élites et les aspirations démocratiques d’une population en quête de stabilité. La Thaïlande parviendra-t-elle à sortir de ce cercle vicieux d’instabilité politique pour se concentrer sur son développement économique et social ?