Togo : Les flammes de la révolte embrasent l’Assemblée, l’opposition défie le silence
Lomé, 1ᵉʳ juillet 2025 – Dans l’enceinte sacrée de l’Assemblée nationale togolaise, trois voix dissidentes ont fait trembler les murs du pouvoir. Les députés de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) et de l’Alliance des Démocrates pour un Développement Intégral (ADDI) ont claqué la porte de la plénière. En effet, ce boycott audacieux de l’opposition résonne comme un cri dans le tumulte d’un Togo en ébullition. Leur geste, loin d’être anodin, est une torche brandie face au silence assourdissant des institutions devant la tempête sociale qui secoue le pays. Le pouvoir en place parviendra-t-il à éteindre l’incendie de la contestation ?
Fronde parlementaire : L’opposition dénonce l’inaction face aux violences
Ce lundi, alors que les travées de l’Assemblée auraient dû vibrer de débats, elles se sont tues sous le poids d’une absence symbolique. Les trois élus, porte-étendards d’une opposition exsangue mais déterminée, ont dénoncé l’inaction d’un exécutif pétrifié face aux vagues de colère populaire. Les manifestations des 26, 27 et 28 juin 2025, qui ont embrasé Lomé, ont laissé derrière elles un sillage de deuil : au moins sept morts, des dizaines de blessés, et un peuple suffoquant sous le joug d’une répression brutale. Ces cortèges, nés d’un ras-le-bol profond contre le régime de Faure Gnassingbé, ont été matés par des forces de l’ordre aux méthodes aussi implacables que controversées.
Par ailleurs, dans un communiqué aussi incisif qu’un manifeste, les députés frondeurs exigent l’impossible : la libération immédiate des manifestants emprisonnés, une enquête indépendante sur les violences policières, et le respect du droit constitutionnel à manifester, ce pilier vacillant de la démocratie togolaise. Leur appel, porté par une indignation légitime, fait écho à une population qui, dans les ruelles de Bè ou sur les barricades improvisées, crie sa soif de justice.
Le pouvoir face au miroir : Accusations de répression et de déni
En face, le gouvernement, retranché dans sa forteresse, brandit une rhétorique défensive. Les manifestations ? Illégales. Les instigateurs ? Des agitateurs, voire des étrangers, accusés de vouloir semer le chaos. Le pouvoir vante le « professionnalisme » de ses forces de sécurité, mais ses mots sonnent creux face aux images de barricades en flammes et aux récits de brutalité. Plus troublant encore, les corps retrouvés dans des cours d’eau, officiellement victimes de « noyades », alimentent un scepticisme corrosif. Dans un Togo où la vérité semble noyée elle aussi, ces déclarations jettent de l’huile sur le feu d’une colère populaire déjà incandescente.
Le Togo au bord du gouffre : Un défi majeur au régime de Faure Gnassingbé
Ce boycott parlementaire n’est pas qu’un geste de désobéissance : c’est un défi lancé au régime de Faure Gnassingbé, dont la dynastie, ancrée au pouvoir depuis 1967, vacille sous les assauts d’une jeunesse désabusée. Les réformes constitutionnelles de 2024, perçues comme un « coup d’État institutionnel », ont transformé le président en président du Conseil des ministres, un poste sans limite de mandat qui cristallise les rancœurs. À cela s’ajoutent aussi une crise économique asphyxiante et une répression qui, loin de briser la contestation, la radicalise.
Les trois députés, en désertant la plénière, ont allumé une mèche. Leur appel à une session extraordinaire pour examiner la crise résonne comme un ultimatum : le Togo ne peut plus étouffer ses blessures sous le silence. Alors que de nouvelles manifestations sont annoncées dès ce 1ᵉʳ juillet, portées par une diaspora galvanisée et des activistes numériques, une question hante les esprits : jusqu’où ce brasier social embrasera-t-il le pays ? Dans les rues de Lomé, entre les pneus calcinés et les espoirs tenaces, une certitude émerge : le Togo, au bord du gouffre, refuse de se taire et de sombrer dans l’oubli.


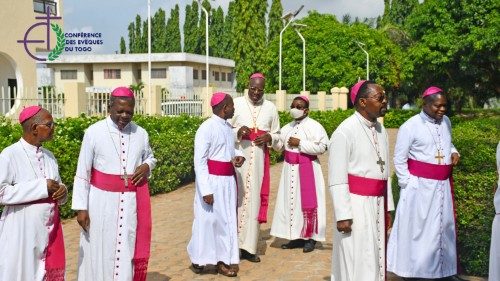


 Un architecte de la santé publique
Un architecte de la santé publique Dr Diallo : un dernier don, une vision pour l’avenir
Dr Diallo : un dernier don, une vision pour l’avenir Un pont entre nations
Un pont entre nations Du dévouement à l’inspiration : le legs du Dr Diallo
Du dévouement à l’inspiration : le legs du Dr Diallo



 Un carrefour stratégique pour le commerce international au Togo
Un carrefour stratégique pour le commerce international au Togo La Chaire OMC de Lomé : Trois piliers pour une stratégie d’influence
La Chaire OMC de Lomé : Trois piliers pour une stratégie d’influence

 Réforme constitutionnelle et dynastie au pouvoir : les racines de l’indignation
Réforme constitutionnelle et dynastie au pouvoir : les racines de l’indignation Entre exil et revendications : Les voix de la contestation togolaise
Entre exil et revendications : Les voix de la contestation togolaise Lomé, carrefour d’un peuple : Entre peur et désir de changement
Lomé, carrefour d’un peuple : Entre peur et désir de changement