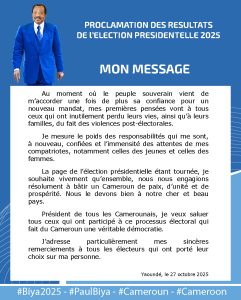Élu à l’unanimité président de l’Assemblée nationale togolaise, Komi Selom Klassou a marqué son investiture par un discours empreint d’humilité, de spiritualité et d’appel à l’unité. Dans un contexte de transition institutionnelle, l’ancien Premier ministre promet un mandat tourné vers la cohésion républicaine et le respect des valeurs parlementaires.
Lomé, 29 octobre 2025 – Dans une séance plénière empreinte de solennité, le professeur Komi Selom Klassou a été élu à l’unanimité président de l’Assemblée nationale togolaise, mardi 28 octobre. Il succède à Kodjo Sévon-Tépé Adedze, récemment nommé au gouvernement de la Vᵉ République. L’ancien Premier ministre prêtera serment pour le reste du mandat parlementaire ouvert en juin dernier. Mais, c’est surtout son discours d’investiture, marqué par la modestie et l’appel à la cohésion, qui a capté l’attention des 109 députés présents.
Klassou : une élection sans suspense, un mandat chargé de symboles
Porté par la majorité parlementaire de l’Union pour la République (Unir), Klassou s’est présenté sans concurrent, recueillant 100 % des suffrages. Il devient ainsi le quinzième président de l’Assemblée depuis l’indépendance. Cette transition, dans le sillage des réformes institutionnelles récentes, s’inscrit dans une logique de continuité.
La séance a également entériné la nomination de quatre vice-présidents – Hadja Mémounatou Ibrahima, Gbalgueboa Kangbeni, Mohamed Saad Ouro-Sama et Pawoumoudom Wella – ainsi que l’installation de quatorze députés suppléants, venus combler les sièges vacants.
Mais au-delà des procédures, c’est la parole du nouveau président qui a donné le ton d’un mandat placé sous le signe de l’unité républicaine.
“Avec une profonde humilité” : les fondations spirituelles d’un engagement
Dès l’ouverture de son allocution, Klassou a invoqué une dimension spirituelle forte :
“Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, source de vie et de sagesse, pour m’avoir permis d’être ici aujourd’hui.”
Ce préambule, loin d’être anecdotique, ancre sa mission dans une posture de service et de responsabilité. Il promet aussi un engagement guidé par la foi, l’intégrité et l’humilité :
“C’est avec Sa force que je m’engage à accomplir cette mission.”
Loin de toute posture triomphante, Klassou insiste sur la gravité de la fonction, qu’il qualifie d’“immense honneur” et de “haute responsabilité”. Il se veut aussi garant des règles, des valeurs et des traditions qui fondent l’âme de l’institution parlementaire.
Hommage appuyé au chef de l’État : loyauté et devoir
Le nouveau président n’a pas manqué de saluer le chef de l’État, Faure Essozimna Gnassingbé, avec une déférence assumée :
“Je rends hommage à Son Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé pour la confiance qu’il a placée en ma modeste personne.”
Cette reconnaissance s’accompagne d’un engagement clair : servir la République “dans l’intérêt supérieur de la Nation”. Pour Klassou, le perchoir n’est pas un piédestal, mais un levier au service du bien commun.
Un appel vibrant à l’unité : “Main dans la main, au-delà de nos divergences”
Moment fort du discours : l’appel à dépasser les clivages politiques. Klassou exhorte ses collègues à faire de l’hémicycle un espace de convergence :
“Travaillons main dans la main pour bâtir une Nation plus forte, plus unie et plus prospère.”
Conscient des tensions inhérentes à la vie parlementaire, il transforme ainsi les divergences en opportunités de progrès. Dans un Togo en pleine mutation constitutionnelle, cet appel résonne comme un manifeste pour une Assemblée rénovée, où le débat nourrit l’action.
Klassou : une Assemblée , prête à relever les défis
La séance du 28 octobre a également permis de compléter le Bureau de l’Assemblée avec l’installation des suppléants. L’institution est désormais en ordre de marche pour aborder les chantiers législatifs à venir, sous la houlette d’un président qui mise sur la sagesse collective.
Ce discours inaugural, sobre mais porteur, trace les contours d’un mandat qui pourrait marquer un tournant. Reste à voir si l’appel à l’harmonie saura se traduire en actes, dans un paysage politique en recomposition. Pour l’heure, les mots de Klassou résonnent comme un rappel : au service de la Nation, l’humilité est une force.