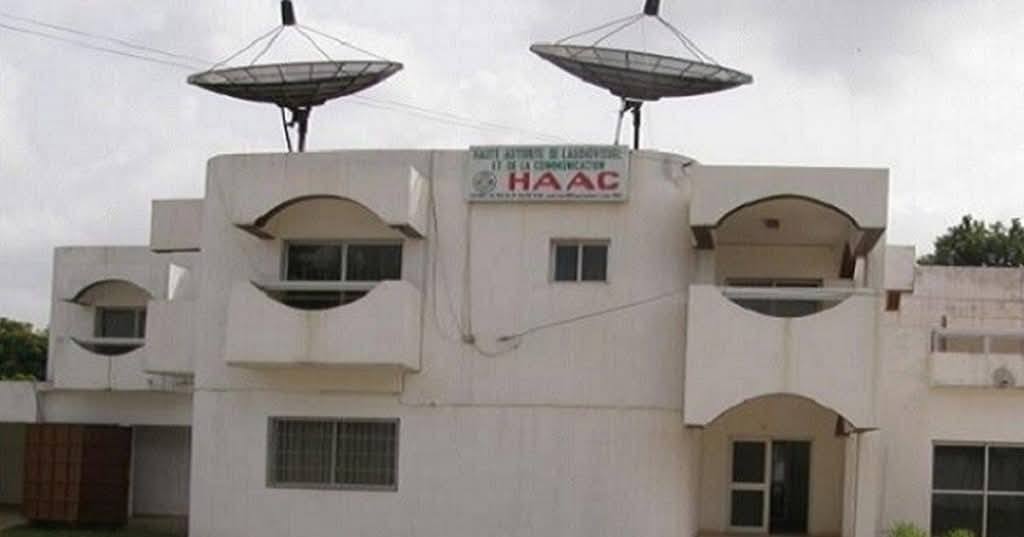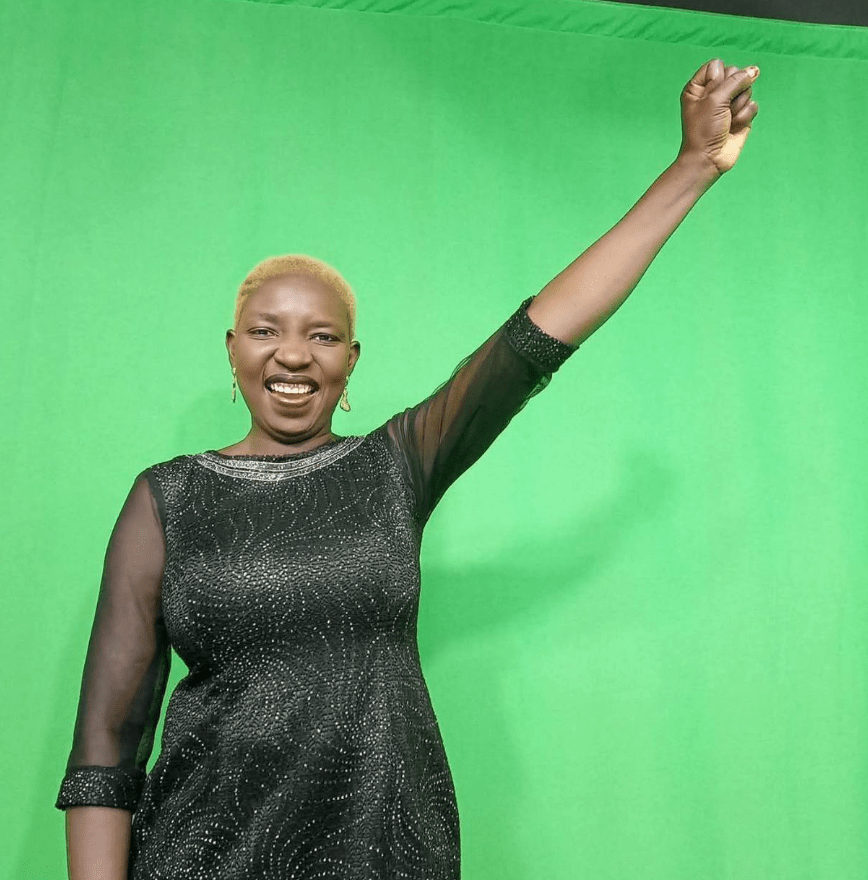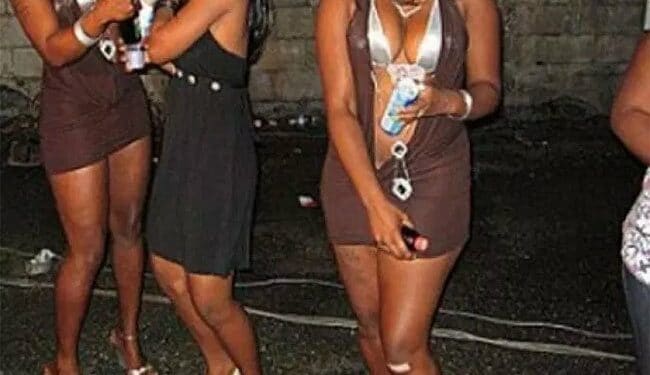Face à une vidéo virale accusant faussement son fils d’avoir été arrêté aux États-Unis avec 12 milliards de FCFA, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, réagit avec fermeté. Il dément catégoriquement les allégations, annonce des poursuites judiciaires et appelle à une régulation stricte de l’espace numérique
Lomé, 7 octobre 2025 – La diffusion d’une vidéo mensongère ciblant une haute personnalité politique peut-elle déstabiliser une carrière diplomatique à l’échelle internationale ? C’est dans ce contexte que le Professeur Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères, a réagi avec fermeté. Ainsi, dans un communiqué officiel publié ce mardi, il a démantelé point par point une rumeur virulente qui a circulé sur les réseaux sociaux depuis le 5 octobre.
La controverse repose sur une accusation : des rumeurs prétendent que les autorités américaines ont interpellé le fils du ministre en possession de 12 milliards de FCFA (environ 21 millions de dollars), insinuant que ces fonds proviendraient d’une source illicite. Par conséquent, le ministre a catégoriquement réfuté cette information, annonçant des poursuites judiciaires immédiates contre l’auteur de la publication initiale, identifié comme Sylvain Dodji Afoua, alias @EgountchiLdna sur X.
Robert Dussey : démenti formel et qualifications pénales
Egountchi Behanzin a posté une vidéo dans laquelle il accuse gravement le ministre :
« Ton fils a été arrêté aux États-Unis avec plus de 21 millions de dollars, soit environ 12 milliards de francs CFA. » Il interpelle directement : « Un mot là-dessus ? Les Togolais veulent savoir comment il a obtenu une telle fortune. Est-ce l’argent volé au peuple togolais, ou celui de la drogue que tu transporterais en profitant de ton immunité diplomatique ? »
En réponse, le Ministre Dussey a qualifié cette allégation
d’« entièrement inventée, fausse et diffamatoire ». Il a clarifié sa position sur son compte officiel, assurant : « Aucun membre de ma famille n’a été arrêté, détenu ou poursuivi en justice, ni aux États-Unis ni ailleurs ».Il a poursuivi en dénonçant un « acte délibéré et malveillant, une pure dénonciation calomnieuse » visant à entacher son honneur et celui de sa famille. Pour le Ministre, ces déclarations sont « erronées, diffamatoires et totalement infondées ».
Menace de poursuites contre les relais de l’information
Le ministre des Affaires étrangères a affirmé sa volonté d’assainir l’espace public et a mis en garde sévèrement quiconque se ferait l’écho de cette fausse nouvelle.
« Des poursuites judiciaires appropriées seront engagées contre toute personne ou tout média qui diffuserait ou répéterait ces erronées allégations », a-t-il prévenu avec détermination.
Cependant, sur X, l’accusateur initial a maintenu l’échange dans une joute judiciaire en temps réel. De plus, dans un pays où les réseaux sociaux sont devenus un nouveau champ de bataille politique, cette affaire met en lumière la guerre globale contre les infox. La propagation de fausses nouvelles est une infraction pénale ; le Ministre Dussey entend faire de ce cas un exemple pour dissuader les auteurs de calomnie en ligne.
En conclusion, face au cyber-harcèlement, le Ministre Dussey adopte une posture de transparence et de rigueur légale pour préserver son intégrité. Cette démarche pourrait servir de précédent pour d’autres personnalités publiques togolaises confrontées aux rumeurs virales. Alors que l’entrepreneuriat et les activités économiques au Togo connaissent un plein essor, ces fausses allégations ne font que perturber le climat de confiance.