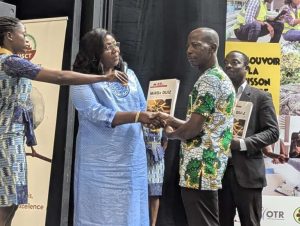À Mission-Tové, le Togo cultive pour l’avenir. Grâce au soutien de la BOAD, un ambitieux projet agricole et social de 14,7 milliards FCFA transforme les terres, les villages et les vies. Irrigation, infrastructures, éducation : le PARTAM redessine le paysage rural avec la souveraineté alimentaire en ligne de mire.
Lomé, 21 octobre 2025 — Dans les verdoyantes plaines de Kovié, au cœur du Togo, un vent de renouveau souffle sur les campagnes. La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) vient de porter une pierre angulaire à l’édifice de la souveraineté alimentaire locale. Grâce à son financement massif, le Projet d’Aménagement et de Réhabilitation des Terres Agricoles dans la zone de Mission-Tové (PARTAM) s’attaque aux racines des défis ruraux : famines sporadiques et précarité quotidienne. Avec un budget global flirtant les 14,8 milliards de FCFA, dont 8 milliards injectés par la BOAD, cette initiative promet de transformer des hectares de terre en greniers prospères et des villages en havres d’opportunités.
Mission-Tové : une offensive multi-fronts contre l’insécurité alimentaire
L’ampleur du PARTAM impressionne. Au menu : une remise à neuf complète du barrage de Zio Kpota, couplée à la restauration du canal d’alimentation et à la revitalisation d’une vaste étendue de 360 hectares déjà en exploitation. Mais le projet ne s’arrête pas là. Il vise aussi à conquérir de nouvelles frontières agricoles en développant 240 hectares supplémentaires, prêts à accueillir semences et sueur des cultivateurs.
Pour que ces terres ne restent pas oisives, un soutien concret aux exploitants est prévu. Des groupements de paysans verront leurs arsenaux s’enrichir d’équipements modernes pour le labour et la conversion du riz en paddy, accélérant ainsi la chaîne de valeur locale. Et pour préserver les récoltes des caprices du climat, 15 entrepôts dotés de zones de séchage émergeront, comme des sentinelles contre le gaspillage.

De la pêche à l’éducation : un écosystème rural repensé
L’agriculture n’est que le premier pilier de cette ambition holistique. Le PARTAM intègre une dimension aquacole audacieuse avec la création de 35 bassins dédiés à l’élevage piscicole, chacun couvrant 625 m². D’ailleurs, ces étendues bleues pourraient bien diversifier les assiettes des familles et générer des revenus complémentaires pour les pêcheurs amateurs.
La mobilité rurale, elle aussi, passe à la vitesse supérieure. Plus de 21 kilomètres de pistes seront refaits à neuf, reliant des fermes isolées aux marchés animés, et facilitant le va-et-vient des marchandises et des hommes. En plus , l’accès à l’eau potable, vital dans ces contrées arides, s’améliore via une petite station de distribution : un réservoir de 50 m³ perché sur un château d’eau, alimentant six points de puisard pour désaltérer les communautés.
Enfin, l’investissement humain scelle l’avenir. Six nouvelles écoles verront le jour pour former les générations montantes, flanquées de 15 installations sanitaires et de cinq espaces dédiés à l’alphabétisation des adultes. Ces infrastructures ne sont pas de vains édifices ; elles incarnent une vision où l’éducation et l’hygiène deviennent des armes contre la pauvreté endémique.
Vers un Togo rural résilient et autonome
En somme, ce projet, financé en grande partie par la BOAD, illustre une synergie réussie entre institutions régionales et besoins locaux. En misant sur l’irrigation, la mécanisation et les services de base, le PARTAM ne se contente pas de combler des manques : il forge une résilience durable face aux aléas climatiques et économiques. Les habitants de Mission-Tové, longtemps aux prises avec des sols ingrats et des infrastructures défaillantes, entrevoient déjà un horizon plus clément.
Reste à suivre les premiers semis et les premiers élèves derrière les pupitres pour mesurer l’impact réel. En attendant, cette initiative togolaise rappelle que l’Afrique de l’Ouest regorge de potentiels inexploités, prêts à éclore sous l’impulsion d’investissements avisés.