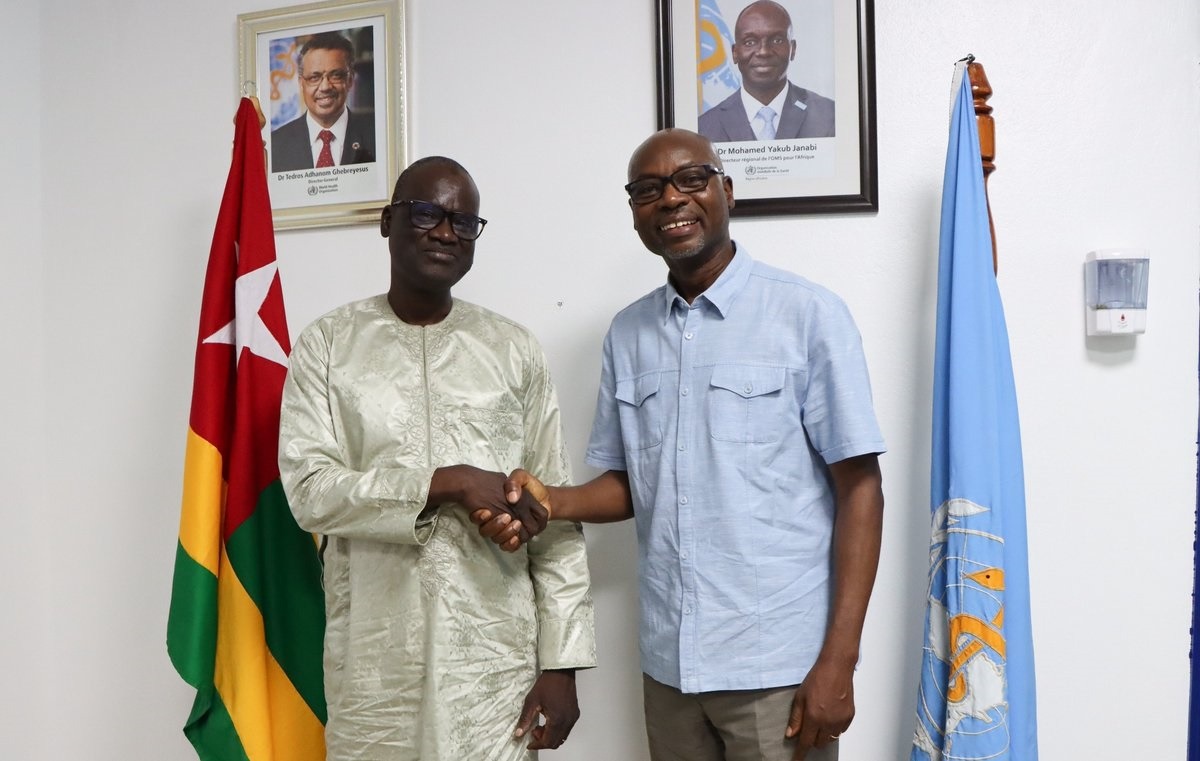Le ministère de l’Environnement lance, ce lundi 26 janvier, une vaste opération de vente publique de bois saisis lors de contrôles contre l’exploitation illégale. Une initiative qui vise autant à renflouer les caisses de l’État qu’à marquer les esprits dans la lutte contre la déforestation.
C’est une caravane d’un genre particulier qui s’élance ce lundi à travers les cinq régions du Togo. Durant dix jours, une délégation du ministère de l’Environnement et des Ressources forestières va sillonner le pays pour vider les dépôts où s’entassent des mètres cubes de bois saisis. En effet, le ministère vendra aux enchères publiques ces essences, arrachées illégalement à la forêt togolaise, sous la supervision directe du ministre de tutelle, le professeur Dodzi Kokoroko.
Une traçabilité retrouvée
L’opération, qui s’achèvera le 5 février, poursuit un triple objectif. Le gouvernement liquide d’abord les preuves matérielles d’un trafic qui, bien que contenu, continue de fragiliser le couvert forestier national. Il réinjecte ensuite ces produits dans le circuit légal afin de générer des recettes pour le Trésor public. Enfin, il offre aux artisans et aux entreprises locales une ressource dont la provenance est désormais certifiée par l’État.
Le calendrier de la tournée, millimétré, traverse les zones de forte pression forestière : des plateaux d’Agou et du Kloto dès le 29 janvier, jusqu’aux savanes de Tandjouaré début février. Dans chaque préfecture, la vente aux enchères se veut un exercice de transparence, loin de l’opacité qui entoure parfois la gestion des saisies administratives.
« L’illégalité ne paie plus »
Au-delà de l’aspect comptable, cette initiative porte un message politique fort. Dans un pays qui s’est fixé l’ambitieux objectif de planter un milliard d’arbres d’ici à 2030, l’État traite désormais le pillage des ressources ligneuses comme un délit majeur contre la sûreté environnementale.
« À travers cette opération, le gouvernement veut montrer que l’exploitation forestière illégale ne paie plus », indique-t-on au ministère. Pour les autorités, l’enjeu est de transformer une perte écologique en un gain civil, tout en rappelant aux réseaux de trafiquants que le bois confisqué finit, systématiquement, par leur échapper au profit de la collectivité.