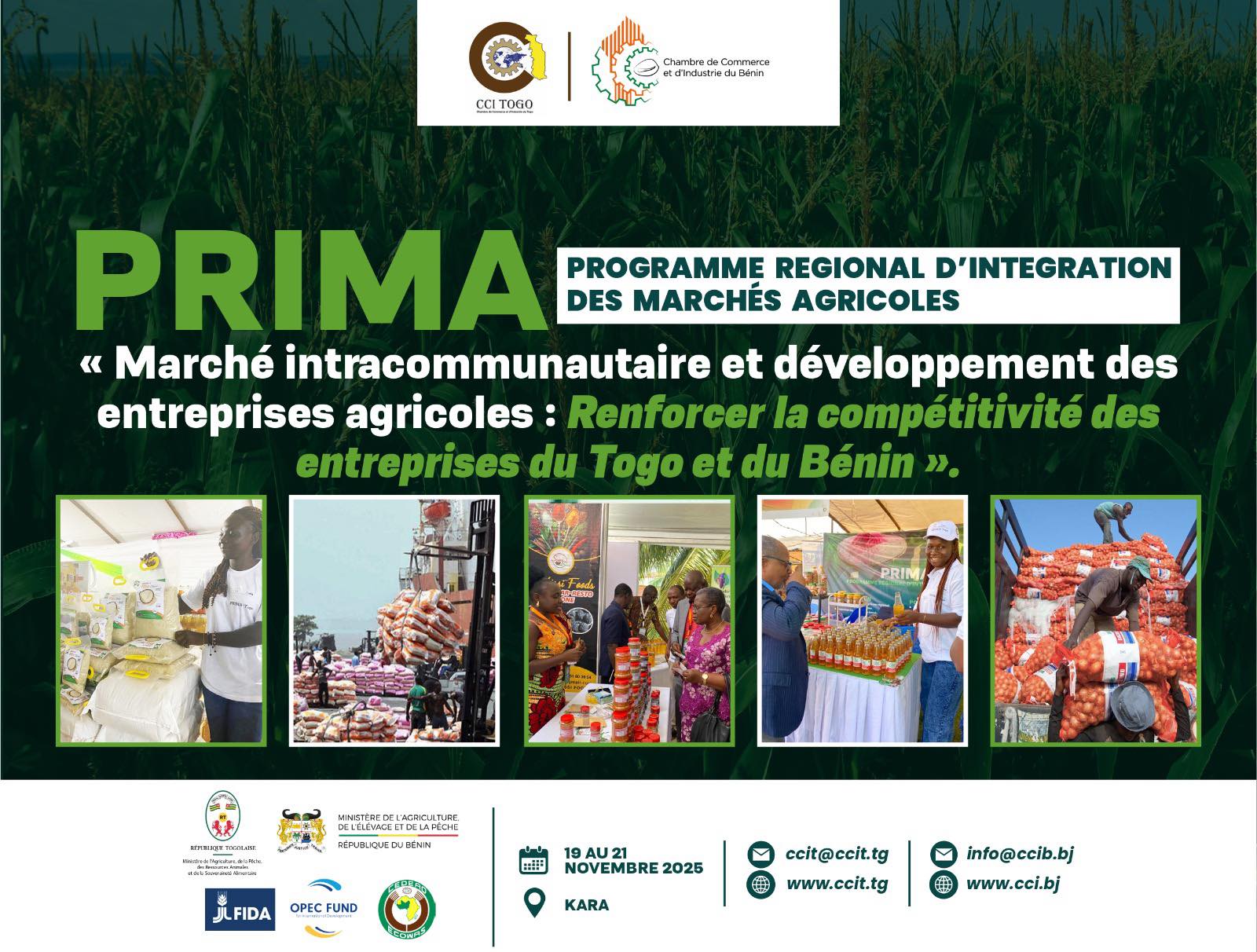À Gbavé, le chantier du Centre Technique National togolais franchit une étape décisive. Validé par la FIFA, ce complexe de 20 hectares financé par le programme FIFA Forward incarne l’ambition d’un football togolais moderne, inclusif et compétitif.
Lomé, 17 novembre 2025 – Le football togolais gagne en ambition avec l’évolution rapide du chantier du Centre Technique National à Gbavé, dans la commune de Zio 2. Dans ce contexte, la FIFA a validé les avancées d’un projet ambitieux financé par ses soins lors d’une mission la semaine dernière. Lancés en avril, les travaux promettent un hub moderne dédié à la formation et à l’excellence sportive, boostant ainsi les Éperviers et la relève nationale.

Une visite FIFA qui confirme l’élan du projet togolais
Concrètement, accompagnée par les équipes de la Fédération Togolaise de Football (FTF), la délégation de la FIFA a inspecté le site de Gbavé, berceau naissant de l’élite footballistique togolaise. Par ailleurs, l’occasion était idéale pour célébrer la finalisation réussie de la pelouse hybride principale, déjà certifiée conforme aux normes internationales. Ce terrain d’exception, prêt à accueillir entraînements intensifs et compétitions, symbolise le premier jalon d’un complexe conçu pour propulser le Togo sur l’échiquier africain.
Les visiteurs ont également passé en revue les phases en cours : construction des résidences pour athlètes, des bureaux administratifs et d’un poste de garde sécurisé. Ces infrastructures, alignées sur les standards mondiaux, visent en effet à créer un écosystème complet où convergent joueurs, staff technique et officiels, favorisant une immersion totale dans le haut niveau.

Satisfaction palpable : la vision d’un centre d’excellence moderne
Par conséquent, après l’inspection technique, la satisfaction était palpable. El Hadji Wack Diop, directeur du bureau Afrique à la FIFA, n’a pas caché son enthousiasme lors de cette évaluation.
« Je ressens une grande plénitude et une tranquillité d’esprit face à un projet qui progresse harmonieusement. Cette infrastructure, une fois opérationnelle, atteindra un niveau d’excellence contemporaine », a-t-il déclaré, soulignant comment cette avancée matérialise une stratégie nationale pour le renouveau du ballon rond togolais.
Ce feedback positif renforce la confiance des autorités sportives locales, qui voient dans ce centre un levier pour l’identification et le polissage des pépites togolaises. Le centre devrait accueillir dès 2026 les premières promotions de jeunes talents issus des académies locales. Au-delà des infrastructures, il s’agit aussi d’un investissement dans l’avenir : des programmes structurés pour former la génération montante et élever les compétences des éducateurs et des arbitres.

FIFA Forward : 1,2 milliard FCFA pour 20 hectares d’innovation sportive à Gbavé
Surtout, soutenu par le fonds FIFA Forward, ce joyau s’étend sur près de 20 hectares et représente un budget de 1,2 milliard FCFA. Plus qu’un simple stade, il incarne une plateforme multifonctionnelle pour stimuler la compétitivité des sélections nationales, des Éperviers aux équipes féminines et de jeunes. En favorisant des stages résidentiels et des séminaires spécialisés, le centre technique ambitionne de combler les lacunes en matière de préparation physique et tactique.
À terme, Gbavé pourrait devenir un pôle d’attraction pour les sélections voisines en quête de préparation de qualité. Les travaux, menés avec une rigueur exemplaire, devraient s’achever dans les mois à venir, ouvrant ainsi la voie à des partenariats élargis avec des clubs continentaux. Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation du football togolais, où l’infrastructure rime avec inclusion et performance.
Vers un avenir radieux pour le football togolais à Gbavé
En conclusion, avec cette validation FIFA, le Centre Technique National de Gbavé n’est plus un rêve : c’est une réalité en marche, prête à forger des champions et à unir une nation autour de sa passion footballistique. Les prochaines étapes, axées sur l’équipement high-tech et les tests finaux, promettent un lancement en fanfare, boostant l’attractivité du Togo pour les investisseurs sportifs.